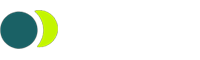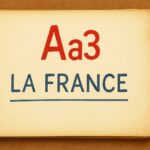Le changement d’heure : une idée logique… sur le papier
Le principe derrière le décalage horaire, vous l’avez compris, est d’une simplicité enfantine : aligner notre journée sur la course du soleil. C’est l’idée géniale qu’a eue l’Américain Benjamin Franklin, au XVIIIe siècle déjà, pour nous faire utiliser moins de bougies. Mais c’est surtout avec le choc pétrolier des années 70 qu’elle est devenue une vraie mesure de politique énergétique. En France, on l’a réintroduite en 1975, juste après ce coup de massue sur le coût de l’énergie. L’objectif était clair : en repoussant d’une heure le moment où l’on allume la lumière le soir, on grappille quelques précieux kilowattheures et, in fine, on allège la facture nationale, et la vôtre avec. Sur le papier, c’est implacable : moins d’éclairage artificiel, c’est moins de dépense.
Aujourd’hui, l’économie d’énergie réalisée grâce au changement d’heure est considérée comme marginale. Les gains sur la consommation d’électricité en France sont estimés à moins de 0,1 % de la consommation annuelle. Pour le consommateur, c’est une somme quasi-symbolique.
analyses de RTE et de l’ADEME
Aligner les activités humaines avec la lumière naturelle
Ce passage à l’heure d’été, puis à l’heure d’hiver, a donc été conçu pour coller au mieux à nos activités. Au printemps, l’heure de lumière en plus le soir est un cadeau : on dîne tard en terrasse, on bricole dehors, on profite simplement. Notre pic de consommation d’électricité, qui est traditionnellement en fin de journée quand tout le monde rentre chez soi et se met à allumer, se décale un peu, et il est surtout moins prononcé. L’idée, c’est qu’en prolongeant la lumière du jour, on évite d’enclencher l’éclairage au moment où le réseau est déjà sous tension pour d’autres raisons, comme la cuisine ou le chauffage. C’est une petite gymnastique horaire qui vise avant tout à lisser la demande sur le réseau et à éviter de devoir mobiliser des centrales très coûteuses en période de pointe.
Si le changement d’heure a permis d’économiser l’équivalent de la consommation d’éclairage de plusieurs centaines de milliers de foyers par an dans les années 90, ce bénéfice est en baisse constante. L’efficacité des ampoules LED a rendu ce mécanisme beaucoup moins pertinent financièrement.
ADEME
Des économies d’énergie… mais dans quelle mesure ?
Alors, est-ce que ça marche toujours ? Mécaniquement, oui, ça a toujours un effet. Les études, comme celles de l’ADEME (l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), confirment qu’on fait toujours des économies d’énergie, principalement sur l’éclairage. Historiquement, les gains étaient énormes. Aujourd’hui, ils sont devenus beaucoup plus minimes, de l’ordre de moins de 0,1 % sur la consommation globale d’électricité selon certains gestionnaires de réseau. Pourquoi cette baisse ? C’est simple : on a fait d’énormes progrès en matière d’efficacité énergétique. Les ampoules LED, par exemple, consomment tellement peu que le bénéfice d’une heure de soleil en plus est largement réduit par rapport à l’époque des vieilles ampoules à incandescence. De plus, l’éclairage ne représente qu’une petite partie de notre facture totale.
Le véritable levier d’économie sur votre facture, ce n’est plus l’heure légale, mais l’isolation, le chauffage et les écogestes quotidiens
Un impact limité sur le portefeuille
C’est la question qui nous intéresse le plus, nous, les internautes soucieux de nos finances personnelles : combien ça représente concrètement sur ma facture ? Quand on parle d’économies de l’ordre de 0,07 % d’électricité au niveau national, vous imaginez bien que pour votre compte en banque, l’impact est, disons-le franchement, proche de zéro. Si on se base sur une consommation moyenne, l’économie annuelle est souvent estimée à quelques euros, voire dizaines d’euros au maximum. C’est une somme symbolique, qui ne changera pas votre budget mensuel. De plus, il y a un effet pervers : le passage à l’heure d’hiver (on recule) fait qu’il fait jour plus tôt, mais aussi nuit plus tôt le soir, ce qui peut nous inciter à allumer plus tôt… ou, pire, à monter le chauffage un peu plus tôt en rentrant, surtout quand il fait froid.
Un effet psychologique et sociétal
Si les gains sont devenus marginaux sur le plan strictement financier, le changement d’heure continue de jouer un rôle, mais plus sur le plan psychologique et sociétal. L’heure d’été, par exemple, a un effet moral non négligeable sur les gens. Elle nous donne cette impression de « plus de temps » et de journées qui durent. On en profite plus, on se sent plus en forme. Pour certains secteurs, comme le tourisme, les loisirs ou la restauration, cette heure de lumière en soirée est d’ailleurs un vrai levier économique indirect : elle pousse à consommer dehors, à prolonger les activités, à circuler. Mais cet effet, s’il est bénéfique pour le PIB, est difficilement quantifiable sur votre propre facture de ménage. Il faut juste espérer que le restaurateur chez qui vous allez profiter du soleil ne répercute pas la petite augmentation de sa propre consommation due à l’heure tardive !
Notre corps est réglé par son horloge biologique interne, le rythme circadien. Même si l’heure d’hiver nous fait ‘gagner’ une heure de sommeil, ce décalage brutal d’une heure désynchronise temporairement la sécrétion de la mélatonine, l’hormone du sommeil. L’adaptation n’est pas immédiate et peut entraîner une irritabilité ou des troubles de l’appétit pendant plusieurs jours.
INSV
Vers la fin du changement d’heure ?
La question n’est plus de savoir s’il fait économiser, mais plutôt pourquoi le maintenir si les bénéfices sont si faibles. Le débat est d’ailleurs relancé très régulièrement. L’Union européenne elle-même a envisagé de le supprimer. Il y a eu une grande consultation où une écrasante majorité des citoyens européens ont dit vouloir y mettre fin. Seulement, le diable est dans les détails. Il faut que tous les pays se mettent d’accord pour choisir l’heure de référence : est-ce que l’on reste définitivement à l’heure d’été (ce qui est le souhait majoritaire des Français) ou à l’heure d’hiver ? Les enjeux ne sont plus seulement économiques, ils sont aussi liés au sommeil, à la sécurité routière et à l’organisation des transports. Pour l’instant, l’harmonisation patine, et donc le changement, on continue.
Un changement d’habitude plus qu’un vrai levier d’économie
En fin de compte, si l’on regarde l’impact sur les finances personnelles, ce rituel ne doit plus être vu comme le Saint-Graal de l’économie d’énergie. Il est dépassé par des gestes du quotidien bien plus efficaces. Ce qui va vraiment faire la différence sur votre facture, c’est d’investir dans de l’isolation, de passer aux LED, de bien régler votre thermostat ou, simplement, d’éteindre les appareils en veille. Là, on parle de dizaines, voire de centaines d’euros d’économies par an. Comparé à ça, le changement d’heure est une goutte d’eau, une tradition qui survit. C’est plus une petite piqûre de rappel annuelle sur la nécessité de faire attention à notre consommation, un peu comme un vieux panneau de signalisation qui nous rappelle la route à suivre.
N’oubliez pas : le changement d’heure, c’est ce week-end !
Peu importe les chiffres et les débats, n’oubliez pas l’essentiel : la transition arrive. La nuit du dernier dimanche d’octobre, on recule la montre d’une heure. À trois heures du matin, il sera donc deux heures. La bonne nouvelle ? On gagne une heure de sommeil. Pour les finances, c’est anecdotique, mais pour le moral, c’est toujours bon à prendre ! Et si vous voulez vraiment voir l’impact de l’énergie sur votre budget, ce week-end, profitez de ce petit temps en plus pour jeter un œil à votre contrat d’électricité et comparer les offres. Ça, au moins, ce sera une vraie économie !

Auteur :
Thierry Chabot
Article publié le
22 octobre 2025
et mis à jour le
22 octobre 2025
Passionné par l'univers de la finance, j'accompagne les particuliers dans leurs choix et décisions pour optimiser leur budget et ainsi faire des économies.