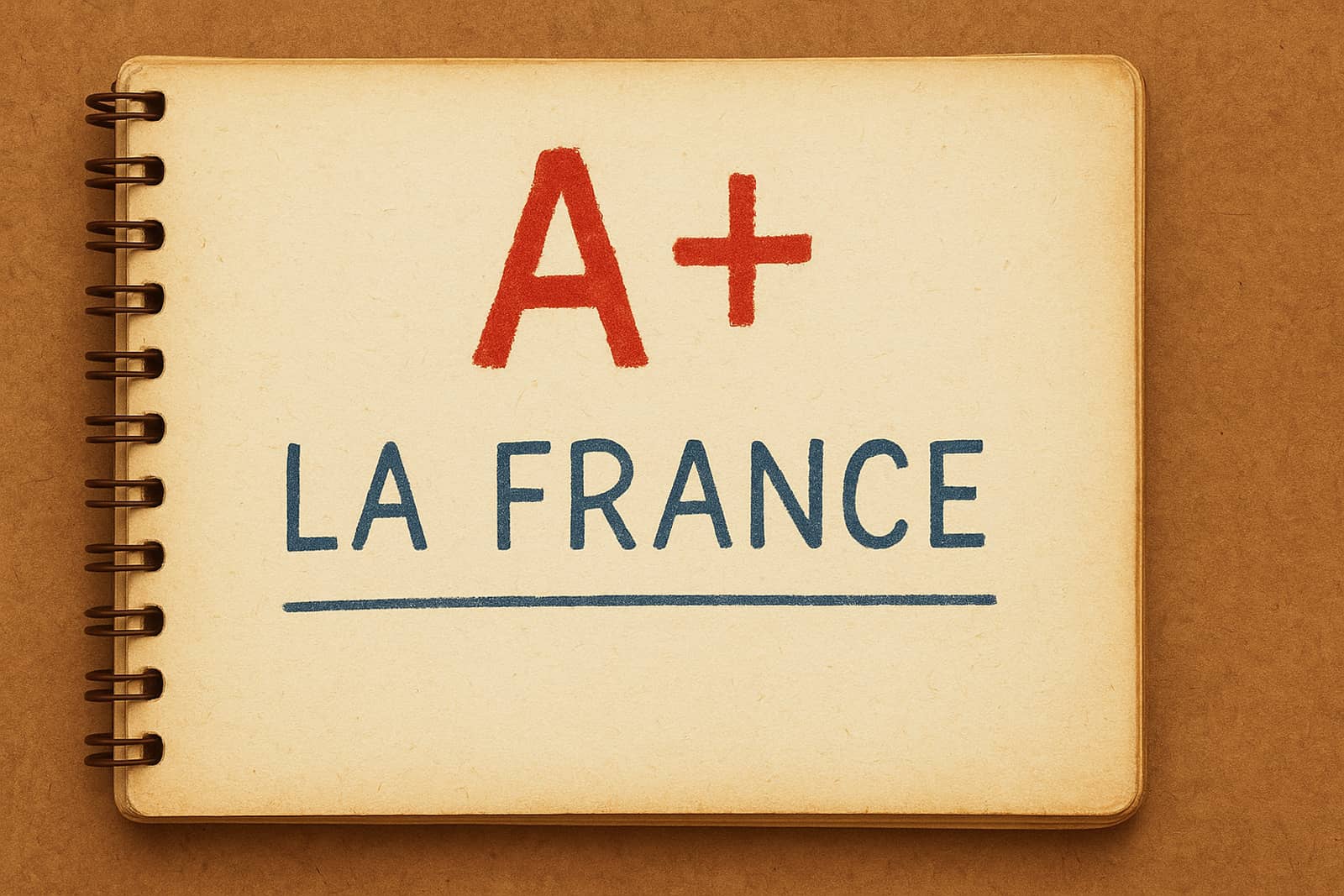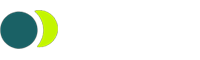Que signifie concrètement le passage de « AA- » à « A+ » ?
Le changement de notation opéré par S&P est avant tout un jugement sur la capacité et la volonté de l’État à honorer ses engagements financiers à long terme, c’est-à-dire à rembourser sa dette. En glissant de « AA- » à « A+ », l’émetteur français quitte symboliquement la catégorie « Double A » chez S&P, pour intégrer le haut de la catégorie « A ». Cette rétrogradation d’un cran indique aux investisseurs que, si la France demeure un débiteur de « haute qualité », son profil de risque s’est légèrement dégradé.
Cette évaluation se fonde sur l’analyse de plusieurs facteurs. L’agence souligne en particulier l’incapacité à réduire significativement le déficit budgétaire, qui se maintient à des niveaux élevés, et l’augmentation constante de la dette publique en pourcentage du Produit Intérieur Brut (PIB). La trajectoire des finances publiques, jugée peu rassurante pour l’avenir, est le point de friction majeur. Pour les marchés, cette nouvelle note agit comme un signal que la France pourrait rencontrer des défis croissants pour maîtriser ses comptes, même si le risque de défaut de paiement reste objectivement très faible.
Le 17 octobre 2025, S&P Global Ratings a abaissé ses notes de crédit souveraines à long et court terme, non sollicitées, en devises et en monnaie locale, de la France à « A+/A-1 », contre « AA-/A-1+ ». La perspective est stable. Les perspectives stables pour la France mettent en balance la dette publique croissante et le faible consensus politique sur le rythme de la consolidation budgétaire avec les atouts du pays en matière de crédit, notamment son économie riche et équilibrée, son épargne privée élevée, son secteur financier important et liquide et son appartenance à la zone euro. Nous pourrions abaisser notre note sur la France si sa situation budgétaire se détériore au-delà de nos prévisions ou si les perspectives de croissance économique se dégradent significativement.
S&P Gloabal
À quoi sert véritablement cette notation et pourquoi est-elle si observée ?
La note souveraine est l’étalon de mesure de la solvabilité d’un État. Sa fonction première est d’offrir un repère simple et standardisé aux acteurs financiers mondiaux, fonds de pension, gestionnaires d’actifs, banques centrales, qui envisagent d’acheter des obligations émises par la France. Elle permet à ces investisseurs d’évaluer rapidement le risque qu’ils prennent.
Plus la note est élevée, plus la dette française est considérée comme sûre et plus l’État peut emprunter à un taux d’intérêt faible. C’est la confiance qui fait le prix. Inversement, une dégradation comme celle que nous observons tend à accroître la prime de risque exigée par les prêteurs. Si les investisseurs perçoivent un risque accru, ils réclameront une rémunération supérieure pour leurs capitaux. Ce mécanisme affecte directement le coût de financement de la dette nationale. La note est donc un instrument de transparence financière, mais également un puissant levier d’influence sur le prix auquel le pays se finance. Elle sert de référence non seulement pour l’État, mais aussi, indirectement, pour l’ensemble des acteurs économiques du territoire, car elle fixe le socle des taux d’intérêt de l’économie.
Quel impact cette révision a-t-elle sur notre quotidien ?
Bien sûr, l’abaissement d’une note ne provoque pas un choc visible immédiat pour le citoyen lambda. Néanmoins, ses conséquences se diffusent progressivement dans l’économie, touchant in fine les finances personnelles. La première incidence se situe au niveau des finances publiques. Chaque point de pourcentage supplémentaire sur les taux d’intérêt de la dette représente des milliards d’euros de dépenses en plus pour l’État. Cet alourdissement du service de la dette réduit mécaniquement les marges budgétaires disponibles. En d’autres termes, les fonds dépensés pour payer les intérêts sont autant de ressources en moins pour financer les services publics essentiels, l’investissement ou d’éventuelles baisses d’impôts.
Par ailleurs, si le coût de financement de l’État augmente, cela peut entraîner une pression à la hausse sur les taux d’intérêt de l’ensemble de l’économie. Les banques, qui empruntent en se basant sur le risque souverain, peuvent répercuter cette augmentation. Pour les ménages, cela pourrait se traduire par des conditions d’accès au crédit immobilier, au crédit à la consommation, ou même au financement des entreprises, plus onéreuses. Pour l’épargnant, cela peut se manifester par une potentielle revalorisation de certains produits d’épargne, notamment l’assurance-vie en euros qui est fortement exposée à la dette française, mais également par une inquiétude concernant la pérennité de la fiscalité locale et nationale qui pourrait être sollicitée pour compenser le déficit.
Faut-il s’inquiéter de cette double alerte, après la dégradation similaire par Fitch ?
Le fait que deux des trois grandes agences aient procédé à la même rétrogradation en peu de temps confère à l’alerte un poids considérable et ne peut être ignoré (voir : La note de la France est passée de AA- à A+ chez Fitch). La convergence des jugements renforce l’idée d’une faiblesse structurelle dans la gestion des finances publiques. Ce n’est pas un signal d’alarme annonçant une crise imminente, la France garde un classement de très bonne qualité, mais plutôt un avertissement sérieux.
L’inquiétude doit se focaliser non pas sur un risque de faillite, inexistant pour un pays membre de la zone euro, mais sur l’impact à long terme de cet endettement accru. Le fardeau de la dette limite la capacité du pays à faire face à des chocs économiques futurs, à investir dans la croissance de demain et à maintenir son modèle social. Ce double déclassement pousse les autorités à présenter, et surtout à mettre en œuvre, une stratégie budgétaire crédible et durable. Pour le citoyen, il s’agit d’une incitation à la prudence et à la diversification de son propre patrimoine, car la dette d’un pays est toujours, d’une certaine manière, celle de ses habitants. L’enjeu est désormais de regagner la confiance des marchés en démontrant une véritable volonté de rétablissement financier.
Comprendre les notes de crédit : un guide simple pour décrypter les évaluations
Nous l’avons vu, la France a récemment glissé d’un cran, passant de « AA- » à « A+ » chez S&P, un mouvement qui, après l’alerte de Fitch, mérite toute notre attention. Ces notes de crédit souverain, loin d’être un simple outil d’économiste, sont un véritable baromètre de la confiance que le monde accorde à la capacité de l’État à gérer ses comptes et à honorer ses dettes. Pour vous permettre de décrypter ces jugements sans avoir à plonger dans le jargon financier, voici un récapitulatif simple de l’échelle de notation utilisée par les grandes agences comme Standard & Poor’s (S&P), Moody’s, et Fitch.
Tableau des notations de crédit souveraines
| Catégorie / Note S&P |
Note Moody’s |
Note Fitch |
Description |
| AAA |
Aaa |
AAA |
Capacité exceptionnellement forte à honorer ses engagements ; risque de défaut minimal. |
| AA+ |
Aa1 |
AA+ |
Très forte capacité à honorer ses engagements ; risque légèrement plus élevé que AAA. |
| AA |
Aa2 |
AA |
Très forte capacité à honorer ses engagements ; vulnérabilité modérée aux conditions adverses. |
| AA- |
Aa3 |
AA- |
Très forte capacité à honorer ses engagements ; plus sensible aux chocs économiques. |
| A+ |
A1 |
A+ |
Forte capacité à honorer ses engagements ; sensible aux conditions économiques à long terme. |
| A |
A2 |
A |
Forte capacité à honorer ses engagements ; vulnérable aux fluctuations économiques. |
| A- |
A3 |
A- |
Forte capacité à honorer ses engagements ; risques accrus en cas de conditions défavorables. |
| BBB+ |
Baa1 |
BBB+ |
Capacité adéquate à honorer ses engagements ; sensible aux variations économiques à long terme. |
| BBB |
Baa2 |
BBB |
Capacité adéquate à honorer ses engagements ; vulnérable aux changements économiques. |
| BBB- |
Baa3 |
BBB- |
Capacité adéquate à honorer ses engagements ; risque accru en cas de conditions défavorables. |
| BB+ |
Ba1 |
BB+ |
Capacité à honorer ses engagements mais vulnérable à court terme (catégorie spéculative). |
| BB |
Ba2 |
BB |
Moins vulnérable que les notations inférieures ; risque notable à court terme. |
| BB- |
Ba3 |
BB- |
Capacité à honorer ses engagements mais fortement dépendante de conditions économiques favorables. |
| B+ |
B1 |
B+ |
Capacité limitée à honorer ses engagements ; risque spéculatif élevé. |
| B |
B2 |
B |
Capacité limitée à honorer ses engagements ; très vulnérable aux changements économiques. |
| B- |
B3 |
B- |
Capacité limitée à honorer ses engagements ; risque élevé de défaut. |
| CCC+ |
Caa1 |
CCC+ |
Très vulnérable ; dépend fortement de conditions économiques favorables. |
| CCC |
Caa2 |
CCC |
Risque élevé de défaut ; dépendance à des conditions économiques exceptionnelles. |
| CCC- |
Caa3 |
CCC- |
Extrêmement vulnérable à court terme ; risque de défaut imminent. |
| CC |
Ca |
CC |
Très spéculatif ; défaut très probable. |
| C |
C |
C |
En défaut ou en risque imminent de défaut. |
| D |
– |
D |
En défaut ; incapacité à honorer ses engagements financiers. |
Notes : Les lignes en jaune indiquent les notations spéculatives (haut rendement), et en rouge les notations en situation de détresse. Moody’s utilise « C » au lieu de « D » pour indiquer un défaut. Sources : échelles standard des agences de notation.

Auteur :
Thierry Chabot
Article publié le
18 octobre 2025
et mis à jour le
18 octobre 2025
Passionné par l'univers de la finance, j'accompagne les particuliers dans leurs choix et décisions pour optimiser leur budget et ainsi faire des économies.